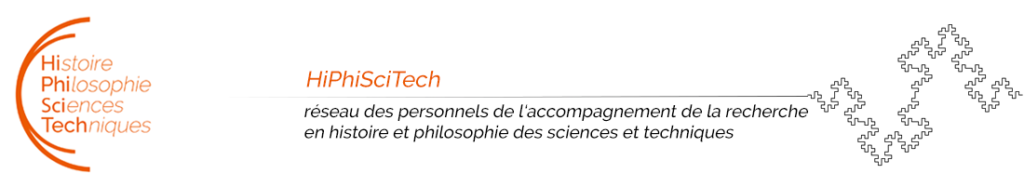|
Différent de l'auto-archivage réalisé par les auteurs, un dépôt sur ces plateformes fait l'objet d'une validation par une commission en relation avec l'établissement de soutenance et est pris en charge par une instance mandatée (Service Commun de la Documentation ; Direction de l'Appui à la Recherche ; Bibliothèque ; ...). |
DUMAS
-> Lien vers DUMASPlateforme de "Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance" Derniers mémoires recensés
À la fin du XIXe siècle, les conceptions philosophiques classiques des sciences physiques ont été bouleversées par certaines avancées scientifiques. En effet, juste avant le renouveau de la physique induit par les deux théories de la relativité d'Einstein, l'essor des géométries non-euclidiennes et la théorisation de l'imprévisibilité de certains systèmes dynamiques déterministes ont donné lieu à des débats philosophiques houleux : que faire de l'a priori kantien et du libre arbitre après ces découvertes ? Ces débats philosophiques basés sur des questions scientifiques sont principalement développés dans des articles de revues, qui se répondent mutuellement. Pour étudier ce corpus, il a fallu identifier les discussions, les structurer et les situer.
Après avoir été effrayé à l’idée de voyager par plaisir en raison de la connotation guerrière de cette dernière mais également d’une peur des reliefs naturels, une nouvelle perception renverse à la fin du XVIe siècle cette pensée. La conception utilitaire du voyage prend l'ascendant au cours du siècle suivant, avec la possibilité d'apprendre et de se forger une culture personnelle jugée essentielle aux nobles de cette époque. Cette conception évolue à nouveau grâce à l'influence des Lumières et de nombreuses découvertes scientifiques ou philosophiques du XVIIIe siècle. La pratique voyageuse est maintenant comprise comme un moyen de connaître la terre, de partager les savoirs pour une plus grande égalité. Dans ce contexte, les scientifiques sont devenues des acteurs centraux, notamment en se rendant directement sur les lieux à expertiser. Ainsi, en plus d'une large publication d'imprimés de relation de voyage fait par des nobles en mission diplomatique ou dans la réalisation de leurs Grands Tours, se développent en parallèle des mémoires scientifiques tirés de leurs voyages. Dans la même période, un nouvel acteur dans le chaînon de l'imprimerie vient bouleverser l'ordre établi au siècle précédent, les périodiques. C'est avec ce nouveau support que les savants-voyageurs ont diffusé non seulement des extraits de leurs mémoires mais également des lettres, des synthèses et des questionnements portants sur les avancées scientifiques. Dans ce microcosme où vivent savants et acteurs de l'impression, de nombreux d’échanges et interactions s’étiolent, tels que des demandes d'instructions spécifiques ou d'aide particulière pour récupérer divers échantillons provenant d'une région lointaine. Cet ensemble se représente également à travers le carnet, un outil essentiel à la sauvegarde des pensées du voyageur qui le suit en toutes circonstances au cours de ses trajets. C'est avec cette source que ce mémoire se propose de retracer la méthodologie d'un savant-voyageur au tournant du XVIIIe siècle en la personne du chevalier Déodat de Dolomieu. Au travers de ses carnets se dévoile les traces de sa pensée savante et des évolutions de cette dernière au cours de ses pérégrinations, permettant la reconstruction d'une méthodologie propre à ce dernier. De même, elle permet la sauvegarde des humeurs de son propriétaire au cours de ses trajets mettant en lumière sa perception de la pratique voyageuse. Enfin, ce même objet se révèle être l'outil le plus essentiel à la propre compréhension de sa conception aux yeux de son propriétaire, ainsi que de pouvoir distinguer si cela est réellement nécessaire les propriétés entre une relation de voyages pour son plaisir et celui d'une relation savante faite pour autrui.
Notre projet de mémoire, ci-dessous développé, est le suivant : comment étudier la notion d'émergence dans le cadre de la métaphysique anglo-saxonne contemporaine ? Pour répondre à cette question, notre réflexion partira du système ontologique particulier, à savoir le "carré ontologique", d'inspiration aristotélicienne et repris par un auteur contemporain, E.J. Lowe. Dans ce système, les catégories ontologique d'"objet", de "phénomène", de "propriété" et de "condition" sont analysées comme étant fondamentales, irréductibles et suffisantes pour décrire tout le contenu de la réalité. Nous nous sommes limités cette année à la présentation de ce système, espérant par la suite pouvoir le développer dans le sens d'un physicalisme non réductif. Notre thèse finale sera alors la suivante : il est possible que de nouvelles conditions émergent.
Nous proposons à travers ce travail de regarder la pensée philosophique comme étant essentiellement liée au phénomène d'ἀνάμνησις, c'est-à-dire au ressouvenir ou à l'anamnèse. Nous cherchons à repenser le propre du philosopher. Dans cette optique, philosopher signifie "se ressouvenir". Pourtant, l'anamnèse n'a pas affaire à la mémoire et aux souvenirs. Elle est expérience, à travers laquelle adviennent une vérité et un savoir. Notre point de départ se trouve dans une évidence de la pensée philosophique : la pensée a une histoire et s'enracine dans une tradition. Tout ce qu'on met devant la pensée, tout ce que la pensée prend comme tâche a un lien avec ce qui a été pensé auparavant ou fait référence à ce qui a été, qu'on l'admette ou non. Nous identifions, cachée sous la forme de cette évidence, une tendance de la pensée philosophique qui n'a pas été mise en question ou explicitée. Ainsi, philosopher c'est dans un certain sens se retourner vers le passé afin de le reprendre sous un jour nouveau. Ce point de départ trouve sa confirmation philosophique à travers une analyse "historique" : l'anamnèse chez Platon et Gadamer. C'est à travers cette façon de mettre à l'œuvre ce que l'évidence nous a dévoilé qu'on découvre que l'anamnèse décrit la recherche et la découverte de type philosophique. Pour Platon, l'άνάμνησις représente moins une actualisation d'un savoir tout fait, inné et latent, qu'une manière de reprendre quelque chose de "su" sous un jour nouveau. C'est donc ce mouvement "rétrospectif" qui rend possible le savoir et la vérité pour la pensée philosophique. Selon Gadamer, l'άνάμνησις platonicienne s'apparente à une re-connaissance. Ces deux analyses dévoilent une certaine "structure" que possède l'anamnèse, un certain mode d'être : elle se définit par le "re-". Il s'agit d'un re-vivre, re-connaître, re-conquérir, re-voir "à distance" la réalité. Ceci renvoie à l'idée de "voir" les choses "dans une autre lumière", ou faire une nouvelle expérience des choses qui apporterait un surcroit de connaissance. Le "re-" de l'anamnèse désigne le fait de re-faire une "expérience". L'anamnèse représente une expérience du philosopher. Philosopher et parvenir à un savoir signifie, dans ce sens, faire l'expérience de l'expérience.
Cette étude tente de répondre à la question "qu'est-ce que le jazz ?" en partant des spécificités musicologiques propres à cette musique pour rejoindre la pensée sociale et culturelle du jazz. Plus qu'un simple travail de définition, il s'agit d'analyser le jazz pour en extraire ses valeurs, d'interpréter les phénomènes musicaux jazzistiques en les plaçant toujours déjà dans un contexte historique et social déterminé. Penser le jazz, c'est établir son unité esthétique. Pourtant, on n'épuise pas le phénomène jazzistique à parler de swing et de sonorité : penser le jazz c'est aussi comprendre les origines musicales d'une telle musique et donc utiliser une méthode généalogique permettant de comprendre pourquoi, un jour, des hommes ont joué de la musique de telle manière. Le discours musicologique s'ouvre à la philosophie sociale et aux sciences historiques. Penser le jazz, c'est alors comprendre qu'il est une musique populaire, issu de la rencontre brutale des musique occidentale et africaine dans le contexte de la ségrégation raciale. Si certains discours sur la musique font de l'abstraction leur crédo, un discours sur le jazz semble devoir nécessairement prendre en compte les contextes socio-historiques dans lesquelles on joue du jazz. Le jazz se joue, se danse, s'incarne dans des gestes, des attitudes et des corps, et ce faisant, véhicule une pensée musicale que l'on ne peut pas comprendre si l'on s'en tient à une analyse musicologique. Penser le jazz comme pensée, ériger le jazz en porte d'entrée privilégiée d'une culture américaine naissante, comprendre l'encrage de la musique de jazz dans la Weltanschauung américaine sont les enjeux de cette étude qui donne en outre des pistes tant méthodologiques que généalogiques pour entreprendre une analyse des musiques populaires postérieures au jazz.
Ce mémoire s'intéresse aux collaborations possibles entre Intelligence Artificielle et philosophie. Il montre que les deux disciplines peuvent partager des objets, des théories et des résultats pour apprendre l'une de l'autre. La stratégie de ce mémoire consiste à expliciter des relations épistémologiques entre les problématiques propres aux deux disciplines ("IA faible" et "IA forte"), afin de définir des modes de collaboration sur le plan disciplinaire. La deuxième partie de ce mémoire présente les travaux de philosophes et de spécialistes de l'IA, depuis les débuts de l'Intelligence Artificielle jusqu'aux années 80. Elle expose les démarches collaboratives exploitées par ces chercheurs, de manière implicite ou explicite. La troisième partie présente des travaux où la philosophie sert de socle conceptuel à l'Intelligence Artificielle, notamment en ce qui concerne la simulation de phénomènes émergents. La quatrième partie réalise un renversement des relations classiques entre les deux disciplines. C'est au tour de l'Intelligence Artificielle de se mettre au service de la philosophie, en formulant de nouvelles hypothèses de recherche ou en testant les théories philosophiques à partir de cas concrets. Ce mémoire, enfin, espère œuvrer pour le rapprochement des deux disciplines et ainsi encourager philosophes et spécialistes de l'IA à collaborer sur les sujets qui leurs sont chers.
|
TEL
-> Lien vers TELServeur de "Thèses en Ligne" et HDR Dernières thèses ou HDR recensées
L’implantation de la Révolution verte a transformé les caféières, associant polyculture et élevage, en monocultures en fonction d’agrochimiques de synthèse. Pesticides, engrais et variétés hybrides à haut rendement et résistantes aux phytomaladies sont des dispositifs technoscientifiques au service du forçage des agroécosystèmes. Nous montrons comment le binôme monoculture/agrochimiques de synthèse a plongé les caféiculteurs dans une crise de valeurs, déterminée par un verrouillage technologique qui a emporté dans une spirale de dégradation la santé publique, la biodiversité des agroécosystèmes et la stabilité politique et économique des populations. Nous soulignons aussi comment les pratiques de pilotage des écosystèmes caféiers, proposées par l’agroécologie, favorisent un agencement pluraliste des valeurs et un déblocage du système technique. Cette thèse mène ainsi une analyse axiologique du sujet pluriel de la caféiculture technicisée dans le département colombien du Quindío.
Le temps de la décroissance de l'activité radioactive de certains radionucléides contenus dans les déchets nucléaires, en dessous d'un seuil considéré comme acceptable, se compte parfois jusqu'en centaines de milliers d'années. Comment les salarié.es de l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (Andra) montrent la sûreté d'un dépôt géologique de ces déchets sur de telles temporalités ? C'est à cette question qu'entreprend de répondre cette thèse, à partir d'une étude des archives de cette agence et d'observation menées au sein de celle-ci.Cette thèse est d'abord une histoire sociale des pratiques savantes mobilisées, depuis les années 1980 jusqu'à 2013, pour étudier l'évolution d'un stockage (géologie, étude des matériaux, simulation numérique...) Elle analyse également le rôle de la recherche dans le gouvernement de l'aval du cycle nucléaire depuis la loi de 1991 qui, en France, encadre la gestion des déchets nucléaires.Bien que l'évacuation géologique soit la seule solution de gestion envisagée pour les déchets radioactifs, la dissociation entre les recherches menées dans le laboratoire souterrain de Bure et leur finalité a permis à l'Andra de s'implanter localement. Cependant, l'Andra se heurte à l'impossibilité épistémique d'appréhender exhaustivement l'évolution d'un stockage sur des centaines de milliers d'années. Désormais, les recherches accompagnent l'implantation du stockage, transformant sans cesse la compréhension de son comportement. Alors que la démonstration publique de la sûreté d'un stockage devient une condition d'acceptation d'un tel ouvrage, l'Andra abandonne peu à peu la prétention à produire une preuve formelle sur le modèle d'une démonstration mathématique : à partir des années 2000, la sûreté repose sur un « faisceau d'arguments » apportant la garantie d'une certaine maîtrise de l'évolution du stockage. Enfin, cette thèse montre au prix de quelles hypothèses la gestion des déchets nucléaires a été promue, durant les années 2000, comme un exemple parfait de démocratie technique.
Certaines théories scientifiques admettent plusieurs interprétations, c'est-à-dire qu'elles sont compatibles avec plusieurs images du monde. J'étudie ici le cas de la mécanique quantique contemporaine comme exemple d'une théorie admettant des interprétations variées. Parmi les interprétations les plus célèbres de la mécanique quantique, on peut citer l'interprétation orthodoxe de Copenhague, celle de la mécanique de Bohm ou celle des mondes multiples d'Everett. Actuellement, il n'existe pas de consensus vis-à-vis de l'interprétation correcte de la mécanique quantique, que ce soit parmi les physiciens ou parmi les philosophes. Cette thèse étudie les enjeux liés à l'existence d'une telle pluralité d'interprétations, à travers plusieurs points de vue méthodologiques. Le premier s'attache à analyser formellement ce que sont les interprétations quantiques et en quel sens ce sont les interprétations d'une même théorie, c'est-à-dire qu'elles restent empiriquement équivalentes. Dans une deuxième partie, je m'intéresse aux rôles que jouent les diverses interprétations quantiques dans la pratique scientifique. J'étudie l'unité qui prévaut dans la recherche en mécanique quantique, en dépit de la diversité des interprétations utilisées. Je propose une notion d'unité fondée sur la réutilisation des travaux scientifiques, lorsque des interprétations différentes sont employées. Dans une troisième partie, je me penche sur les aspects normatifs de la pluralité d'interprétations. Je cherche à savoir sous quelles conditions une telle pluralité peut être bonne pour le fonctionnement de la recherche et le progrès épistémique. Je propose pour cela un modèle de théorie des jeux.
Cette thèse à caractère biographique est une étude de la carrière et de l'œuvre scientifiques de Gaspard-Gustave de Coriolis (1792-1843), polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, dont le nom est universellement connu (force de Coriolis), mais dont le parcours et l'œuvre multiforme sont peu connus. Le fait que Coriolis fasse l'intégralité de sa carrière comme enseignant, puis directeur des études à l'École polytechnique, et que par ailleurs il participe à l'évolution de l'École et du Corps des ponts et chaussées à partir de 1830, nous donne un éclairage intéressant sur ces institutions (notamment grâce à la correspondance privée de Coriolis de 1838 à sa mort). Concernant son œuvre scientifique, sont rappelés ses apports de mathématicien. Son œuvre se caractérise principalement, toutefois, par une approche avant tout mathématique et théorique de la mécanique appliquée aux machines - il établit les fondements d'une théorie du travail. Cette approche et les résultats importants qui peuvent être attribués à ce savant, comme la définition physique du travail, les forces d'entraînement ou les forces centrifuges composées (forces de Coriolis), témoignent du lien tissé par Coriolis entre la mécanique rationnelle des géomètres et la mécanique appliquée à l'industrie naissante des machines.
Il est notoire que la relation traditionnelle entre économie et sociologie est le conflit. Mais je montre que l'importance de ce conflit est minorée par les économistes. Car si la sociologie, initialement positiviste, s'est construite par opposition à l'économie classique, l'ensemble des écoles économiques marginalistes se sont elles aussi construites par opposition à la sociologie positiviste. Lorsque le dialogue théorique existe, il passe par la sociologie économique. Certains voudraient assimiler la sociologie économique à une branche de la sociologie [Smelser, Swedberg, 1994]. Je montre que la forme traditionnelle prise par la sociologie économique passe par la reconstruction de l'autre science (et non la coopération) et que ce processus de reconstruction à mobilisé des auteurs de chaque camp, et pas seulement des sociologues durkheimiens. Actuellement, le pilier sociologique de la sociologie économique est fortement associé au courant de pensée gravitant autour du sociologue Mark Granovetter, et se réclamant de Max Weber [Smelser, Swedberg, 1994, repris par Steiner, 1999]. Ce courant de pensée se sent quelques affinités avec le courant institutionnaliste. Il a aussi été signalé des affinités avec les travaux d'Alan Kirman. [Steiner, 2005]. En sélectionnant trois concepts issus de la nouvelle sociologie économique (le capital social, l'encastrement social et le réseau social), je montre qu'en fait Alan Kirman représente ici de nombreux économistes. Sachant que les concepts de capital social et d'encastrement social peuvent se ramener au concept de réseau social, il est tentant de réduire l'étude des réseaux sociaux à la seule analyse des réseaux sociaux produite par les granovetteriens tels que Linton Freeman et Stanley Wasserman [Freeman, 2004]. Or, une ligne de clivage importante sépare la définition des réseaux qui les considère comme des objets réels (substantivisme) et la définition qui les considère comme de purs concepts mathématiques (structuralisme) [Mercklé, 2004]. Je montre que cette ligne de clivage a laissé des traces au coeur même de l'analyse des réseaux sociaux. Il est connu que l'approche structurale des réseaux est dominante, et représenté l'état le plus avancé de l'analyse des réseaux sociaux [Mercklé, 2004]. Mais si cette approche existe, c'est parce que les sociologues qui l'ont fondée (Harrison White et Mark Granovetter) ont identifié structure sociale et réseau social. Autrement dit, le point central de convergence entre économistes et sociologues n'est pas méthodologique (l'usage des réseaux sociaux définis structuralement) mais théorique (l'identification de la structure sociale à un réseau social). Je montre ensuite que l'économie des réseaux, largement initiée par Alan Kirman à partir des années 1990, s'inscrit dans une logique où le système des prix est déterminé par une structure sociale réticulaire. Parmi toutes les approches économiques qui utilisent le concept de réseau, l'économie des réseaux est donc celle qui est la plus proche de la sociologie de Harrison White et de Mark Granovetter. Je me suis alors attaché à retracer l'histoire de l'économie des réseaux, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à ce jour. Une fois assuré que la sociologie économique contemporaine concentre l'essentiel des relations théoriques entre sociologie et économie, et que le lien le plus étroit unie d'une part la nouvelle sociologie économique, formalisée ou non par l'analyse des réseau sociaux, et d'autre part l'économie des réseaux, j'ai ensuite cherché à décrire cette proximité méthodologique et théorique, en auscultant les modèles mathématiques existants. L'économie des réseaux repose sur un formalisme apte à uniformiser l'écriture de la plupart des modèles économiques [Sanjeev Goyal, 2007]. Malheureusement, ce méta modèle n'a été que partiellement construit. Je me suis donc attaché à achever sa formalisation. Ensuite, j'ai vérifié que ce méta-modèle pouvait prendre en charge l'intégralité de l'analyse des réseaux sociaux. Le propos de la thèse est donc démontré : le concept de réseau social permet l'établissement d'une convergence méthodologique et théorique entre l'économie des réseaux et la sociologie structurale, que cette dernière soit formalisée selon l'analyse des réseaux sociaux ou non. Toutefois, ce résultat peut être étendu. Je montre en effet que les modèles d'Alan Kirman, typiques de l'analyse des réseaux, peuvent être traduits dans le langage de l'analyse complexe, y compris pour les modèles les plus proches de la sociologie. En appliquant le formalisme de l'analyse complexe à la théorie des marchés de Harrison White, je montre enfin que cette forme particulière de sociologie économique s'intègre parfaitement au cadre général de l'analyse systémique. La conclusion qui s'impose est que l'important rapprochement entre disciplines permis par l'analyse des réseaux sociaux fusionnée à la théorie des jeux au sein de la théories des jeux en réseaux (telle que pratiquée par l'économie des réseaux) n'est qu'une modeste partie des convergences bien plus importantes encore qui sont en train de se mettre en place entre sciences à travers l'émergence du paradigme de la complexité.
Cette thèse s'inscrit dans une recherche visant une modélisation des organisations par une "Simulation Professionnelle". Elle est centrée sur les comportements de coopération et de compétition. Les matériaux sur lesquels elle se fonde ont été recueillis au cours de huit années de mise en œuvre du support de Simulation Professionnelle ECODEV pour la formation et le perfectionnement des cadres. Une première partie a pour objet de situer le contexte culturel dans lequel ECODEV a été construit, en donner une description structurelle et dynamique. On étudie également une bibliographie de travaux voisins, touchant directement la coopération et la compétition, ainsi que les coalitions dans les triades. Dans la seconde partie, il est proposé, en partant de la théorie des jeux, un ensemble conceptuel pouvant constituer une grille de lecture d'une Simulation Professionnelle. On est conduit à une mise en relation ternaire des actions, structures d'interaction et comportements. La troisième partie met en rapport théorie et pratique en faisant le parallèle entre un scénario rationnellement prévisible et des cas observés. On formule des hypothèses sur le développement des organisations et sur les contraintes de modélisation de leur développement. Enfin, dans une quatrième partie, une ouverture est faite sur des courants de pensée et de pratiques actuelles en matière de modélisation. Ses éléments sont puisés dans des domaines variés, allant de l'informatique à la théologie, en passant par la biologie.
L'épidémie de SIDA a impliqué, au milieu des années 1980, une accélération de la réorientation des politiques publiques à l'égard des usagers de drogues. Elle a notamment conduit à la mise en place d'un système de soins chargé d'accueillir les toxicomanes. Indirectement, cela a permis de bénéficier de nouvelles sources de données qui ont autorisé une meilleure connaissance du phénomène d'usage de drogues. Néanmoins, les parcours d'usage ne peuvent que rarement être étudiés. Soit les sous-populations sont non représentatives de l'ensemble des usagers de drogues, soit le mode de collecte biaise les indicateurs qui peuvent être obtenus. Nous avons donc d'une part présenté la sélection opérée sur les différentes sous-populations d'usagers de drogues et proposé les méthodes de collecte qui éviteraient de telles sélections. D'autre part, nous avons élaboré, à partir des principes de l'analyse démographique, une estimation des biais induits par l'utilisation d'enquêtes en population générale afin de nous assurer de leur possible utilisation. Il semble que les biais sont assez faibles pour que puissent être réalisées des études qui n'en souffrent pas trop. Ce n'est toutefois que par le renouvellement de ce type d'enquêtes que les mesures pourront être affinées et nous en convaincre avec certitude. Il est toutefois dès à présent certain qu'une amélioration des données collectées est nécessaire pour comprendre la dynamique qui participe au renouvellement des sous-populations d'usagers de drogues. Il est à ce jour évident que plusieurs types d'usage de drogues existent, mais aucune source de données ne permet en France de mesurer la modification d'un type d'usage à un autre.
Cette thèse s'insère dans le programme du Centre F. Viète "Histoire comparée des paysages culturels portuaires" et porte sur la compréhension de l’évolution scientifique et technologique des ports de Brest (France), Mar del Plata et Rosario en Argentine à l’époque contemporaine. L’hypothèse de recherche est de considérer un port comme un macro-système technologique complexe dont l’évolution spatiotemporelle en tant qu'artefact s’inscrit dans une histoire des sciences et des techniques. Ces artefacts sont considérés comme indicateurs signifiants de cette évolution. L'objectif de cette thèse est de bâtir une histoire comparée des ports, de proposer et de valider de nouvelles méthodes de travail en humanités numériques. Pour satisfaire à ces objectifs, nous avons produit une histoire comparée des ports considérés. Puis, nous avons développé un modèle d'évolution de ces ports, appelé HST-PORT, à partir du métamodèle SHS, ANY-ARTEFACT. A partir du modèle HST-PORT, nous avons conçu une ontologie de référence, appelée PHO (Port History Ontology). Cette dernière est fondée sur l’ontologie CIDOC-CRM et en reprend donc le modèle évènementiel. Cette ontologie a été évaluée avec succès en reproduisant l’histoire comparée des ports considérés faites par des historiens. A terme, il s'agit de concevoir de nouveaux systèmes d'information fondés sur ces ontologies et le web sémantique pour indexer, publier et d'interroger des sources historiques afin de produire une histoire comparée.
Dispositif central de l’astronomie, le télescope est aussi l’un des tout premiers instruments scientifiques. Nous proposons d’en livrer une analyse novatrice basée sur la mécanologie génétique. Cette méthode d’analyse des structures et des évolutions des objets techniques est notamment inspirée des travaux de Jacques Lafitte et de Gilbert Simondon. Il s’agit en particulier de repérer l’apparition de nouveaux schèmes techniques et de les rattacher à la lignée technique à laquelle ils appartiennent. Dans ce contexte, nous développons un certain nombre de concepts et d’outils afin d’extraire, de formaliser et d’enrichir les connaissances portant sur les inventions apparues au cours du processus de concrétisation des lignées techniques de télescopes. Les informations recueillies ne sont pas de simples données archivées : leur formalisation à l’aide de diagrammes en fait des connaissances technologiques, qui éclairent le fonctionnement de l’instrument et permettent d’en retracer la généalogie. En analysant les processus de conception, ainsi que la compétition entre les différentes lignées de télescopes, nous parvenons ainsi à une meilleure compréhension des logiques d’évolution technique qui sous-tendent le développement de ces instruments, et à la formulation de tendances techniques très générales. Elles se doublent, dans le cas des télescopes, de logiques évolutives plus spécifiques, résultant d’impératifs performatifs externes et de nécessités techniques internes. L’explicitation de ces logiques, ainsi que des processus émergents auxquels elles donnent naissance, permet de comprendre les dynamiques sur le temps long et d’anticiper les difficultés pour les missions futures. Ainsi, notre démarche ne se veut ni normative, ni positive : par une dialectique constante entre la formulation de nos « lois d’évolution » et les données historiques, nous entendons dégager avec une certaine objectivité des régularités au sein de l’évolution des télescopes, dans une perspective historique qui se veut à la fois rétrospective mais aussi prospective.
La thèse comprend trois parties dont la première vise à définir le contexte historique et culturel dans lequel se développa la production littéraire prise en considération. Nous y décrivons la position d’infériorité relative qui était, depuis l’Antiquité, celle des praticiens (mechanici) par rapports aux lettrés et, plus généralement, aux représentants des arts libéraux. Nous décrivons ensuite le milieu dans lequel évoluèrent les auteurs des dialogues étudiés, c’est-à-dire la cour, centre névralgique et décisionnel de la société à cette époque et qui, passage obligé de l’ascension sociale, était aussi un milieu hostile et très fortement concurrentiel. Le prince occupait le sommet de sa hiérarchie et se situait au cœur des dynamiques internes qui l’animaient. Les techniciens tels que certains des auteurs des ouvrages étudiés devaient se confronter à ce milieu s’ils espéraient faire carrière. Les possibilités d’évolution professionnelle et sociale qui s’ouvraient à eux étaient réelles : les États italiens montrèrent en effet au XVIème siècle un intérêt certain pour les disciplines techniques et proto-scientifiques. Dans ce contexte, la production textuelle représentait un moyen d’action de première importance. Le livre pouvait en effet être conçu comme une monnaie d’échange dans les relations courtisanes, mais aussi comme un succédané à l’action militaire ou comme un moyen efficace pour la promotion des compétences de l’auteur. La deuxième partie de la thèse nous rapproche des textes qui forment le corpus de recherche. Le fait que ces ouvrages traitaient d’affaires militaires représentait un atout dans les cours de la péninsule au XVIème siècle et pouvait leur assurer une réception favorable tout en ouvrant des perspectives de carrière à leurs auteurs. Le premier chapitre de cette partie vise donc à montrer comment était perçue l’utilité de l’art militaire à cette époque. Si la rhétorique faisait de son exaltation un véritable lieu commun, la réalité historique conduisait à un constat unanime : celui de la nécessité urgente pour les États de la Péninsule, qui subirent des échecs cuisants dans la première partie du siècle notamment, d’améliorer l’efficacité de leurs armées. La production d’ouvrages militaires aux finalités didactiques s’encadre, en partie tout du moins, dans ce contexte et répond à la volonté de proposer une instruction militaire plus avancée. La manière dont les auteurs des dialogues étudiés cherchèrent à répondre à ce besoin vital dépendait substantiellement de leur conception de l’art militaire. On en distingue trois principales à cette époque mais toutes préconisent, dans des proportions et selon des modalités différentes, l’union des connaissances théoriques et pratiques. Les hommes de métiers – des membres de l’aristocratie ayant souvent reçu une certaine formation culturelle – revendiquaient la supériorité des savoirs pratiques et critiquaient ceux que l’on appellera les théoriciens purs. Dans leurs ouvrages, ils arrivaient parfois à remettre en cause la pertinence d’une transmission des savoirs militaires par l’écrit. Le paradoxe n’est cependant qu’apparent : la notion clé de l’experimentum – qui peut s’accommoder du support écrit – permet de le résoudre. L’approche de type humaniste, de son côté, relève d’une perspective générale et aristocratique de l’art. Le recours aux auctoritates antiques y est fréquent et les vertus classiques occupent une place de premier ordre. Enfin, les techniciens de la guerre faisaient des mathématiques le fondement essentiel de leur conception de l’art militaire moderne. Ces mathématiciens praticiens soutenaient avec une force particulière la revalorisation des savoirs théoriques déjà en cours dans d’autres disciplines artistiques. Les évolutions radicales qui caractérisent l’art de la guerre au XVIème siècle sanctionnèrent l’efficacité d’une telle approche. Surtout, le recours aux mathématiques représentait la possibilité d’un ennoblissement de métiers qui n’étaient plus seulement « mécaniques ». De cette promotion intellectuelle, les ingénieurs pouvaient tirer des bénéfices notables en termes d’évolution professionnelle et aspiraient parfois à l’accession à un statut social supérieur. La troisième et dernière partie de la thèse consiste en l’analyse des dialogues du corpus : une analyse des moyens – rhétoriques, stylistiques et plus globalement formels, avec une attention particulière l’exploitation du genre dialogique – mis en œuvre par leurs auteurs pour atteindre les objectifs qu’ils souhaitaient atteindre à travers la publication de leurs ouvrages. Ces objectifs fondamentaux, que l’on a décrit d’un point de vue théorique dans la première partie, sont la promotion des compétences de l’auteur et la réalisation d’une transmission de savoirs efficace afin de faire des dialogues des outils potentiels pour l’amélioration de l’efficacité militaire. La dimension didactique des textes étudiés est évidente et le recours au genre dialogique pouvait se présenter comme une option séduisante dans ce but, même pour les représentants de l‘approche technicienne. Toutefois, et c’est là l’objet du dernier chapitre de cette partie, les auteurs des dialogues militaires devaient impérativement se conformer aux modalités de la communication courtisane pour assurer le succès de leur production textuelle et, par conséquent, des stratégies qu’elle pouvait servir. En d’autres termes, les dialogues devaient plaire au public des cours : l’aspect dilettevole (plaisant, agréable) – qui se traduit en grande partie par le soin accordé à la forme – représentait également un atout non négligeable face à la rude concurrence auxquels les ingénieurs étaient confrontés.
|